L’Entreprise robuste


Hamant, O., Charbonnier, O. & Enlart, S. (2025). L’Entreprise robuste. Pour une alternative à la performance. Odile Jacob
Our opinion
Ce mois-ci nous avons choisi un livre qui propose une réflexion sur ce qui pourrait faire la « robustesse » des entreprises face aux fluctuations violentes du monde à venir. Il discute de la nécessité de changer radicalement le modèle actuel de la robustesse, basé sur la santé économique, elle-même basée sur la « performance ». Le livre s’interroge sur les alternatives, et se tourne vers l’exemple du vivant, qui a traversé 3,5 milliards d’années de turbulences grâce à une robustesse basée sur une articulation entre la stabilité et l’adaptabilité. La thèse du livre est que cette robustesse est non seulement affranchie de la nécessité de la performance, mais construite sur la non-performance. S’inspirer du vivant impliquerait donc de repenser fondamentalement nos économies et nos sociétés pour les arracher à leur addiction à la performance. Le livre discute la validité, le réalisme et l’acceptabilité sociale d’une telle perspective. Il n’est pas sans contradictions et affirmations discutables, mais il suscite effectivement la réflexion, et nous en recommandons vivement la lecture.
Notre synthèse
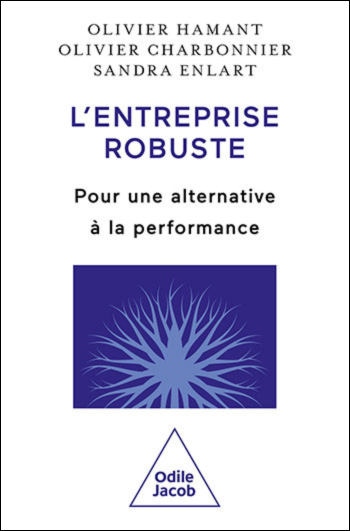
Le conseil de lecture de ce mois-ci concerne un ouvrage publié aux éditions Odile Jacob en janvier 2025, sous le titre L’entreprise robuste et le sous-titre Pour une alternative à la performance. Il est coécrit par trois auteurs :
- Olivier Hamant est biologiste, chercheur à l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et il dirige l’institut Michel Serres.
- Olivier Charbonnier est directeur général du groupe Interface et cofondateur de Dsides. Il conseille les organisations sur les transformations de nos façons de travailler et d’apprendre.
- Sandra Enlart est directrice de recherche en sciences de l’éducation à l’université Paris Nanterre. Elle a été professeure à l’université de Genève et directrice générale d’Entreprise&Personnel, un réseau associatif de ressources humaines.
Ce livre propose une réflexion sur ce qui fait, ou pourrait faire, la « robustesse » des entreprises dans le contexte de fluctuations violentes dans lequel nous sommes entrés. Toute la thèse du livre tourne autour de l’antagonisme, et donc de l’arbitrage incontournable, entre « performance » et « robustesse », métaphoriquement illustrés par l’histoire et la logique du vivant.
Introduction de l’ouvrage
La « performance » y est définie dès l’introduction comme la somme de l’efficacité (la capacité d’un système à atteindre ses objectifs) et de l’efficience (sa capacité à les atteindre avec le moins de moyens possibles). Et pour les auteurs, la « robustesse » est la capacité du système à se maintenir dans un état stable (à court terme) et viable (à long terme) malgré les fluctuations.
Une fois admis le vocabulaire choisi (nous y reviendrons), le livre pose une question d’une actualité brûlante, sans mauvais jeu de mots : qu’est ce qui peut générer la résilience – pardon, la « robustesse » – des entreprises face à la violence des déstabilisations à venir ? Et peut-on s’inspirer du vivant, qui a survécu à 3,5 milliards d’années de transformations extrêmes de son environnement (climatique, chimique, géologique) ?
Chapitre premier
Le premier chapitre rappelle d’abord brièvement que l’humanité n’a jamais fait l’expérience des fluctuations à venir, et que l’agriculture et la sédentarisation, qui ont au plus 10 000 ans, se sont développées dans l’holocène, une anomalie de stabilité climatique. Ces fluctuations seront d’abord socio-écologiques et impliqueront toutes les facettes de notre civilisation : économiques, financières, sociales, géopolitiques. Il rappelle également le caractère dérisoire de la réponse sociétale actuelle, comparant l’effet des appels du GIEC, de l’IPBES, ou de l’UICN à l’indifférence distraite qui accueille la présentation de l’instruction « brace, brace » (appelant à se recroqueviller sur son siège avant le crash) lors des démonstrations de sécurité en avion.
Le chapitre propose ensuite des explications à ce double constat, et en décrit les implications sociétales. L’explication centrale est ce que les auteurs appellent « le piège de la performance ». En cherchant à sécuriser ses conditions de vie face aux prédateurs et à dépasser le minimum vital, l’humanité a maîtrisé le feu, inventé la poterie, domestiqué des animaux, etc. Elle a ainsi pu générer une certaine abondance. Or, « La biologie indique que les êtres vivants répondent en général à l’abondance des ressources par de la compétition ». La compétition engendre alors la recherche de performances supérieures, par la rationalisation et l’innovation, la prédation sans limite des ressources, ainsi que par des formes de domination visant à accroitre et à accaparer le surproduit social par la contrainte. La performance et l’abondance entrent ainsi dans une dynamique de catalyse mutuelle, devenue exponentielle avec la révolution industrielle et le capitalisme, puis les formes successives de celui-ci : libéralisme, néo-libéralisme, ultralibéralisme... Comme celle de la reine rouge dans Alice au pays des merveilles, « la course à l’optimisation n’a pas de ligne d’arrivée ». Les implications sociétales sont notamment le développement permanent de « l’autonomie productiviste » et d’une « hyper-disponibilité » des individus, qui grignote inexorablement la « dernière frontière » (la maison et le corps), le tout encadré paradoxalement par des « systèmes de contrôle indirects de plus en plus puissants », exacerbés par le développement de la digitalisation, et plus récemment de l’intelligence artificielle.
Deuxième chapitre
Le second chapitre propose alors en contraste un résumé très intéressant des mécanismes de robustesse du vivant. Au lieu de la lutte permanente contre la nature, de la prédation des ressources jusqu’à épuisement, et de la compétition généralisée, le vivant se construit sur l’interaction avec et l’adaptation à son environnement, la circularité des échanges et la coopération. Contrairement à une fascination répandue pour l’efficacité et l’efficience supposées du vivant, et contrairement à ce que pourrait laisser croire l’excitation actuelle pour la conception et l’innovation biomimétiques, le vivant n’est – à part quelques exceptions – pas performant. L’immense majorité des espèces marchent à l’énergie solaire, directement (organismes photosynthétiques) ou indirectement (tous les autres). Or, le rendement de la photosynthèse (transformation de l’énergie solaire en énergie métabolique) est dans le cas général inférieur à 1 % ! Le reste de la chaîne alimentaire n’est guère plus performant : la perte d’énergie à chaque niveau successif (herbivores, carnivores) est de l’ordre de 90 %. Donc « le vivant n’est pas du tout performant », et cela « parce qu’il a inventé les conditions dans lesquelles le gâchis n’est pas un problème » : toute la biomasse produite réintègre le cycle du vivant.
Vient alors l’argument qui inspire la thèse centrale du livre : « la robustesse du vivant se construit contre la performance », et cela dès le niveau moléculaire. On résume ici les nombreux gaspillages énergétiques évoqués : la prépondérance de l’hétérogénéité (« la diversité est la marque de fabrique du vivant »), des redondances, beaucoup d’aléas, des délais, des cycles lents (ex. cycles hormonaux) entraînant des déphasages, « des erreurs à tous les tournants. Des mutations aléatoires dans les protéines du système immunitaire les rendent plus ou moins efficaces, mais c’est justement cette diversité qui leur permet de répondre à des pathogènes inattendus ».
Et un point important : « Dans les réseaux du vivant on trouve de nombreuses boucles d’amplification, ce qui permet une grande réactivité […], mais ces boucles d’amplification sont toutes associées à des boucles d’inhibition. C’est un peu comme si dans votre voiture vous aviez le pied sur le frein et sur l’accélérateur en même temps. Quel peut bien être l’avantage évolutif d’une telle incohérence biologique ? Elle […] permet de générer des comportements oscillants capables non seulement de stabiliser les dynamiques internes, mais aussi de résister aux fluctuations extérieures ».
Les paragraphes suivants dégagent alors un certain nombre de leçons potentielles de cette analyse du vivant. Par exemple :
- « L’analyse du vivant nous dit que le meilleur bouclier contre un monde instable n’est pas la consolidation, c’est l’inconstance et les contradictions permanentes ».
- « Le vivant n’évite pas les fluctuations, au contraire il vit par et pour les fluctuations. Être vivant, c’est être variable ».
- « A court terme c’est bien la stabilité qui est favorisée par des comportements peu performants qui nourrissent la robustesse. A plus long terme, ce n’est plus la stabilité mais la viabilité qui est favorisée par les mêmes mécanismes ».
- « La performance se justifie dans un monde stable, aux ressources abondantes, et en paix. Elle n’a aucun sens dans un monde instable, en pénurie de ressources, ou en guerre. Nous ne pourrons pas habiter le monde turbulent qui arrive avec plus de performance. Nous ne devrions pas répondre aux conséquences négatives de la performance par plus de performance. Paradoxalement, c’est la performance qui nourrit le conservatisme en nous enfermant dans une voie confortable et sécurisante à court terme, mais fragile à moyen terme ».
Troisième chapitre
Ce chapitre dresse alors une sorte d’état des lieux des mécanismes d’adaptation et de gestion des risques actuels des entreprises. Il commence par le constat qu’il ne faudrait pas opposer naïvement une performance fragilisant les entreprises et la non-performance du vivant générant sa robustesse, car les entreprises sont loin d’avoir un fonctionnement optimal et une performance très élevée. Il s’agit le plus souvent d’une lourdeur endémique, et parfois d’un fonctionnement absurde. Cette non-performance-là n’est pas génératrice de robustesse.
Certes, en matière d’adaptation, des modèles organisationnels et managériaux fondés sur la recherche de souplesse se sont multipliés dans les dernières décennies, à la fois pour répondre aux exigences de souplesse du marché et pour sécuriser l’appareil de production : « organisation en mode projet, méthodes agiles, démarche de simplification ». Mais le résultat est souvent loin des promesses, et relève de la souplesse plus que de la robustesse. « Il s’agit toujours de viser une productivité et une compétitivité élevée », tout en tenant « compte de certains paramètres instables dans l’équation économique ».
Alors, la gestion des risques est-elle le véritable antidote aux turbulences ? La réponse est non, car « la crise socio-écologique sans précédent que nous traversons est avant tout celle du risque lent ». Les modifications, même violentes, apportées aux écosystèmes (ex. le remembrement agricole) ne se traduisent que très longtemps après par des rétroactions négatives pour les humains. Les outils de la gestion des risques ne savent pas travailler à ces horizons de temps. Ils décomposent les risques en catégories multiples, perdant ainsi la trace de leur interaction systémique. Ils accumulent les contraintes autour des risques connus, et rigidifient ainsi le fonctionnement des entreprises au détriment de leur adaptabilité dans un monde hyper-fluctuant.
Le chapitre se termine en interrogeant le rôle de la RSE : est-ce une voie de salut pour véritablement intégrer la responsabilité sociale et environnementale dans le portefeuille des risques des entreprises, ou est-ce plutôt une aubaine pour optimiser l’image de marque et le bilan fiscal de l’entreprise ? Dans une discussion argumentée, les auteurs constatent, sans surprise, que la réponse est plutôt du côté de la seconde option, alors qu’elle devrait urgemment répondre à la première.
Un premier commentaire de Jean Pariès, rédacteur de ce conseil de lecture :
Le lecteur prend conscience à l’occasion de cette discussion qu’un certain flou entoure la notion de risque dans ce chapitre. De quel système, de quelles perturbations – et de quels risques associés – s’agit-il lorsqu’on parle de la « robustesse » des entreprises ? S’agit-il de leur survie économique ? des conséquences de la crise écosystémique (par exemple la montée des risques NaTech) ? des dommages qu’elles font elles-mêmes subir à l’environnement et à la société du fait de leurs activités ? Cela n’est pas précisé. On a le sentiment qu’il s’agit de tout à la fois, sans que l’articulation entre ces risques soit évoquée.
Cependant, à l’échelle d’une entreprise individuelle, tous ces risques co-existent en effet, et il n’y a donc pas une, mais plusieurs « robustesses », en conflit partiel. Les entreprises doivent arbitrer entre ces robustesses pour trouver un compromis « résilient » (qui optimise leurs chances de survie). Or, la logique d’arbitrage est d’abord nécessairement une « chrono-logique » : personne ne survit à long terme sans d’abord survivre à court terme.
Et dans la grande majorité des cas, la survie à court terme passe par la performance économique. Ce qui, à l’échelle supérieure, mine en effet la soutenabilité de cette économie. Tragédie des communs : personne ne veut mourir durable…
Quatrième chapitre
L’ouvrage aborde alors avec ce chapitre sa question centrale : « l’analogie vivant-entreprise est-elle pertinente ? ». En d’autres termes, « La robustesse du vivant construite contre la performance pourrait-elle représenter une piste de réflexion nouvelle et stimulante pour interroger la manière dont le monde de l’entreprise et celui du travail doivent penser leur propre mutation ? ». Jusque-là une réponse positive était fortement suggérée, mais il s’agit maintenant de poser plus clairement les limites de la métaphore.
Après avoir rappelé les séductions de l’analogie au sein des entreprises elles-mêmes, notamment dans les formations des managers et les différents modèles importés (consultants, sportifs, militaires...), les auteurs évoquent l’intérêt de penser l’(auto)organisation ainsi que la coopération à l’aune du vivant. Mais ils mentionnent les limites de l’analogie – comparaison n’est pas raison – en décrivant les singularités de nos systèmes sociotechniques par rapport à la logique du vivant.
« Interaction, circularité et coopération sont trois caractéristiques essentielles du vivant. La force de ces fonctionnements réside dans un système auto-organisé, sans qu’il soit nécessaire d’imposer une hiérarchie contrôlante. […] Alors peut-on imaginer une entreprise qui fonctionnerait en intégrant de manière invisible, sans hiérarchie, une sorte de programme émergent permettant l’adaptation permanente ? Peut-on par exemple considérer que l’essentiel de la responsabilité managériale est justement dans la conception de cette programmation invisible ? ».
Plusieurs arguments de réponse négative sont exposés. D’abord, contrairement aux êtres humains et à leurs sociétés, le vivant biologique n’est pas téléologique (il ne poursuit aucun objectif ni ne suit de plan d’action), même si sa montée en complexité au cours de son histoire peut, vue de l’extérieur, donner l’illusion d’une création ou d’une finalité. D’autre part, « ce qui fait tenir un groupe social, ce sont des mythes, une langue, une culture, des normes, des habitudes sociales souvent peu efficaces, voire absurdes, un imaginaire, des religions, bref tout une série de comportements et pratiques qui n’ont aucune justification du côté du vivant ». Par conséquent, poser par exemple un objectif de pénurie pour stimuler la coopération en imitant ce qui se passe pour le vivant ne serait « certainement pas réaliste ou enviable ». Par ailleurs, les institutions humaines ne sont jamais seulement une émergence de processus d’auto-organisation. Elles sont toujours en même temps le résultat d’un projet, d’une conception, de décisions, de jeux de pouvoir et de conflits. Enfin la perspective d’adopter les caractéristiques majeures du vivant – « hasard, redondance, gaspillage, fluctuations, incohérences, lenteurs et hésitations, erreurs et imprécisions, inachèvement et imperfections » – poserait un gros problème d’acceptabilité sociale. « Même au nom d’un intérêt supérieur bien compris, comment rendre acceptable dans la société du XXIe siècle ce qui ne peut être perçu que comme un retour en arrière, une aberration sociale et un risque majeur d’inégalités ? ».
La dernière section de ce chapitre s’intitule « Faut-il renoncer à l’analogie avec le vivant ? ». D’une façon assez attendue au vu de l’argumentaire précédent (mais assez inattendue dans l’esprit de l’ouvrage déroulé jusque-là), la réponse est… plutôt « oui, il faut renoncer à l’analogie ». Mais elle reste ambigüe : il faudrait « plutôt utiliser les règles du vivant dans une démarche d’ouverture d’esprit et de stimulation intellectuelle de façon à penser autrement les questions d’entreprise ».
Commentaire :
Il est souvent fécond dans un ouvrage collectif qu’une articulation incomplète des pensées individuelles laisse transparaître des contradictions et laisse le lecteur faire sa propre synthèse. Mais ici, une certaine frustration ternit la fécondité. La réponse apportée à la question très clairement posée par le titre du chapitre 4 est floue, et l’impression domine qu’un débat mieux explicité et assumé entre les auteurs aurait permis une clarification des idées, et au moins du vocabulaire. En effet, que signifie « établir une analogie » entre une entreprise et le « vivant » ? Et de quel vivant parle-ton ? Une grande partie des « caractéristiques » du vivant décrites dans ce livre concernent le « vivant biologique », principalement les cellules. Mais il est aussi question d’êtres vivants (… la crevette pistolet et sa pince géante…), de sociétés animales (bancs de poissons, vols d’oiseaux, colonies d’insectes – « les fourmis n’ont pas de projet d’entreprise »). Et il est bien question des entreprises, mais également des sociétés humaines, et même de l’humanité tout entière et de l’écosystème Terre. Il semble évident qu’avec de tels changements d’échelle, les « analogies » potentielles ne peuvent se situer qu’au niveau des principes fondamentaux et à des niveaux d’abstraction très élevés. Cela n’a aucun sens de transposer directement la notion de « pénurie » du vivant biologique en « pénurie des biens de consommation », ou « carence des services publics ».
Cinquième chapitre
Ce chapitre propose ensuite des exemples d’organisations à visées « robustes ». On ne développera pas ici ces exemples faute de place, et nous renvoyons le lecteur intéressé au livre. Mais l’impression générale est cependant celle d’un décalage entre les exemples décrits et l’application des grands principes de robustesse - de l’analogie avec le vivant - tels qu’ils ont été développés dans le début du livre. Les cas d’étude présentés décrivent effectivement des hiérarchies beaucoup plus plates, davantage d’auto-organisation, et une prise de distance avec les obsessions de la compétitivité, mais il s’agit dans tous les cas d’organisations de petite taille et au statut atypique (coopérative, village, laboratoire universitaire), et leur « robustesse » principale est la soutenabilité (économie circulaire, économie de ressources) davantage que la durabilité.
Sixième chapitre
Ce chapitre reprend et condense les transformations suggérées par l’analogie de la robustesse du vivant pour « Devenir une entreprise robuste ».
Une première rupture est de « Dérailler » : Ouvrir le cadre mental des décideurs au monde fluctuant. II s’agit de bousculer l’idée dominante chez les dirigeants qu’en devenant plus performante, plus grande et plus forte, l’entreprise n’en serait que plus robuste. Cette hypothèse n’est valable que dans un monde stable et abondant en ressources. Dans un monde fluctuant, la rentabilité corrèle d’abord avec la robustesse avant la performance. Et il faut questionner les produits souvent absurdes de la performance et ses conséquences délétères comme la violence. Il s’agit également de convaincre d’accepter l’incertitude, d’abandonner l’illusion du contrôle total, de valoriser la sérendipité, et d’apprendre à « grandir sans s’agrandir, à sortir de la tentation de la croissance à tout prix ».
Un deuxièmement changement serait d’inverser le cadre spatio-temporel dans lequel le travail et son organisation ont été installés depuis la révolution industrielle.
L’accroissement du niveau de prescription et de surveillance, et l’accélération face à l’urgence génèrent de la contrainte et de l’urgence, et enferment dans la fragilité et l’immobilisme socio-écologique. Il faut laisser émerger des zones tampons, se donner des marges de manœuvre. L’entreprise y perdra en performance mais gagnera en robustesse. Cela implique des modifications des pratiques de gouvernance et managériales pour aller vers « l’entreprise délibérée » au sens de « on y délibère », où la primauté est donnée au collectif, au commun et à la coopération.
Il s’agit enfin d’inverser le lien entre activités et environnement : dans le monde de la performance, on s’inquiète de l’impact de l’activité sur l’environnement (question du développement durable), il s’agit désormais de poser la question inverse de l’impact de l’environnement sur nos activités.
L’évolution des espèces procède également par l’introduction de ruptures générées par des variations aléatoires dans le code génétique et la sélection de ce qui est survivable. La robustesse du vivant suggère « d’arrêter d’empiler les couches » de modernité (ex. digitalisation) sur des structures sociales vieillissantes et de « simplifier par et pour la coopération », en repensant les modèles d’organisation et de production pour faire commun (concevoir des tâches partagées, des règles adaptables, etc.). Plus généralement, il s’agit de « ne pas éviter, mais construire sur, les fluctuations » et favoriser la diversification.
Enfin, dernière suggestion de changement inspirée par l’analogie avec le vivant : « ancrer son activité dans le territoire », consolider son rapport au local pour sécuriser ses approvisionnements, et renforcer les interactions avec l’environnement au lieu de s’en distancier en l’artificialisant.
Conclusion de Jean Pariès
Ce livre ne cache pas qu’il a trois auteurs. Il ne prétend pas à une synthèse achevée entre leurs pensées, et en conserve quelques approximations, voire contradictions.
Nous avons déjà noté un flou sur l’objet de la « robustesse ». S’agit-il de rendre les entreprises individuellement robustes face aux grandes fluctuations à venir (climatiques, économiques, géopolitiques, etc.) ? Ou symétriquement de les faire entrer collectivement dans un changement de paradigme civilisationnel de nature à enrayer la marche vers des fluctuations catastrophiques ? Il ne s’agit pas de la même « robustesse », du même rapport à la performance, ni de la même relation à l’analogie du vivant.
Mais ce flou découle peut-être d’un loup lexical. Parler de « performance » (définie comme la capacité d’un système à bien atteindre ses objectifs) pour le vivant, qui n’a aucun objectif, pose un problème. De même qu’opposer « performance » (définie comme ‘efficacité’ + ‘efficience’) à « robustesse », alors que l’efficience est elle-même une forme de robustesse (invariance de l’efficacité face à la raréfaction des ressources). Ces approximations sémantiques expliquent une part de la difficulté à tisser l’analogie entre la robustesse des entreprises et la robustesse du vivant.
Or, de façon surprenante pour un livre inspiré de la biologie, les auteurs prennent soin de se démarquer fortement de la notion de « résilience ». Pourtant le mot « résilience » est le terme consacré, dans la plupart des disciplines scientifiques concernées (écologie, théorie des systèmes complexes adaptatifs, sciences de la sécurité…) pour désigner justement ce qu’ils appellent « robustesse » : la capacité d’adaptation, de réadaptation et de survie d’un système face à l’ensemble de ses déstabilisants. La « robustesse » désignant plutôt l’invariance d’une propriété systémique par rapport à une perturbation spécifique. En d’autres termes, la notion de résilience intègre les arbitrages entre les différentes exigences de robustesse.
La littérature sur la résilience des systèmes complexes adaptatifs décrit l’essentiel des caractéristiques exposées dans ce livre : sous-optimalité (et non pas anti-performance) pour générer et maintenir des marges, diversité, génération de déviances qui créent de la diversité potentiellement vertueuse correspondance structures-fonctions dynamique et adaptable, homéostasie par compensation des fluctuations à l’intérieur du domaine d’adaptation (ou de conception), mécanismes de « coping » prolongeant les capacités de compensation, et dégradation non brutale des comportements au voisinage de la frontière du domaine d’adaptation, rôle décisif de la coopération, capacité de redéfinition de la hiérarchie des objectifs et des valeurs, capacité de décision « sacrifiante »(« part du feu » des pompiers), etc.
Mais il semble que, dans l’univers managérial, le mot résilience soit passablement galvaudé. Il serait entendu dans son sens psychologique principalement. C’est bien dommage. Mais si, pour accéder à l’attention des managers, il faut l’abandonner au profit du terme robustesse, peut-être faut-il s’y résoudre.
Alors qu’apporte de plus, ou de différent, ce livre sur l’analogie vivant-entreprises ? Il propose incontestablement une réflexion approfondie sur la relation performance-robustesse (résilience), un exposé très pédagogique sur la « non-performance » du vivant, qui incite effectivement à la réflexion, et une discussion salutaire sur les limites de la métaphore.
Et au terme de la lecture de cet ouvrage, que l’on recommande vivement, on se dit qu’il illustre assez bien ce qu’il dit du vivant : c’est son inachèvement, son imperfection, ses approximations et ses contradictions qui font sa force.

